On ne bâtit pas des alternatives au modèle économique dominant sans saisir la nature de la crise et les fondamentaux de l’économie dominante d’aujourd’hui. Si notre diagnostic est approximatif, les remèdes proposés risquent de l’être également. Il faut donc cerner de plus près l’organisation économique et sociale qui est la nôtre que certains nomment pudiquement une économie de marché et d’autres, de plus en plus nombreux, qui n’hésitent plus à nommer un chat un chat : le capitalisme.
À propos du capitalisme : quelques clés de compréhension
Le problème, lorsqu’on fait une analyse critique forte du capitalisme, c’est qu’il existe dans la tête de beaucoup de gens, surtout au Québec, une arrière-pensée à l’effet qu’en rejetant ses fondamentaux et pas seulement ses dérives, nous serions dans l’obligation de conclure à la nécessité de la «révolution». Pointe alors l’imaginaire du socialisme à la manière des révolutions russe, cubaine, vietnamienne ou chinoise. On voit alors se surgir à l’horizon un socialisme autoritaire conçu comme monopole de l’économie par l’État et la mainmise de ce dernier sur l’organisation générale de la société. Cela bloque notre réflexion.
Pourtant, même un vieux dominicain comme le Père Benoît Lacroix (97 ans) n’hésite pas, dans une entrevue accordée au journal Le Devoir (6 août 2012) à afficher ses couleurs sur cette question : Le Père Benoît Lacroix, lance, le dos droit et le regard vif, sans hésiter que « le capitalisme devrait disparaître le plus vite possible. Il n’a pas joué son rôle ». Et plus loin, dans l’entretien, d’ajouter : « Sortir d’un capitalisme devenu «vicieux», çà tient la route… ». Le capitalisme a manqué le train. Il menace son cher fleuve, qui a bercé son enfance… Le Père Lacroix ne dit pas tout mais c’est une invitation à réfléchir sans ce point aveugle dans notre approche du changement social. Historiquement, le socialisme autoritaire a bel et bien existé et a été omniprésent dans le monde. Je me suis déjà expliqué à ce propos dans un autre billet, lequel traitait entre autres de la fin des communismes. L’histoire du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux en général nous apprend que le socialisme autoritaire n’a pas été la seule réponse au capitalisme même lorsqu’il a été vertement critiqué non pas uniquement pour ses dérives mais dans ses fondamentaux. Voici donc 10 idées reçues sur le capitalisme qui nous permettra en partie du moins de clarifier le paysage et de mieux voir comment on peut changer le monde aujourd’hui.
Première idée reçue : le capitalisme est un « système » !
Quels sont les fondamentaux du capitalisme qui n’en font pas seulement un secteur, même dominant, de l’économie. Trois choses : en premier lieu, le capitalisme est porteur d’une vision de la société qu’on peut résumer par la formule du « tout au marché », c’est-à-dire que le marché est la clé principal de tous nos problèmes que ce soit l’exploitation des ressources naturelles, l’agriculture, l’accès à l’eau, l’éducation ou la santé sans oublier la protection de la nature, les énergies renouvelables et que sais-je encore!
En second lieu, c’est la domination d’une économie mobilisée autour d’une seule et unique logique, la logique du profit maximum et tout particulièrement à partir de grands secteurs stratégiques de l’économie. C’est une « économie capitaliste de marché » comme le dit si justement Riccardo Petrella (Petrella, 2012) et elle est dominante. Représentante type de cette économie : la firme multinationale. Secteurs stratégiques les plus dynamiques à l’heure actuelle: la finance, les pétrolières et les gazières, les minières, les constructeurs automobile, les agroalimentaires. Caractéristique de base : miser sur «la concentration de la propriété des moyens de production et de distribution entre les mains des plus puissants grâce à leurs richesses» comme le dit Claude Béland (président de Desjardins de 1987 à 2000) après bien d’autres (Le Devoir, 7 août, p.A7).
En troisième lieu, le capitalisme cherche aussi à avoir une emprise sur l’ensemble de la société : non seulement régir l’ensemble de l’économie ou presque mais rechercher tendanciellement que la société soit régie par le marché. Il cherche à avoir une emprise sur l’État et les partis politiques (par ses lobbies notamment), sur le système d’éducation et de santé, sur les médias d’information, sur les universités et même sur les biens qu’on considère généralement comme des biens communs (l’eau, la terre…). En deux mots, la tendance qu’il cherche à imposer: créer une «démocratie conforme au marché» de dire la chancelière allemande, Angela Merkel (Nouvel Observateur, 2 août 2012). Autrement dit, tout peut devenir marchandise. La notion de biens communs n’existe pas.
La notion de « système », si fréquemment utilisée à gauche pour en parler, est une notion-massue. On est pour ou on est contre, c’est donc dire qu’il faut choisir son camp en quelque sorte. Le problème, c’est que cela ne laisse aucune place aux dynamiques sociopolitiques – souvent fort diverses – des mouvements sociaux, des partis politiques, des régions, des communautés locales. Qu’on soit aux É-U, en Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique latine n’a en dernière instance aucune importance. À cette notion fermée, je préfère celle de «mode d’organisation d’une économie» et de «modèle économique dominant», le capitalisme étant celui qui tend à régir ou à vouloir régir toute la société. Face à cela, dans toute société, des contrepoids ont toujours émergé pour contrer cette tendance de telle sorte que «le système» n’est pas le même partout parce qu’on peut l’infléchir, créer des marges de manoeuvre, le limiter, le contraindre, voire même le transformer pour mettre au coeur de cette organisation de la société des alternatives qui le dépassent et qui vont au delà de sa suprématie.
Historiquement, les pays scandinaves ont démenti cette domination d’un « système capitaliste » omniprésent. Sans tomber dans le piège du socialisme autoritaire, ils ont régulé très fortement le capitalisme, avec un filet social solide, au point où plus de 55% de l’économie relève du secteur public et plus de 15% relève des coopératives et autres entreprises collectives (comparativement aux ÉU où seulement 30% de l’économie relève de l’économie publique et où les coopératives, les mutuelles et les syndicats sont de peu de poids). Ce qui me fait dire qu’il n’y a pas un capitalisme mais des capitalismes (j’y reviendrai dans un second billet). Et les pays scandinaves en sont arrivés là parce que des forces sociales – syndicats, coopératives et autres associations citoyennes de même que des partis politiques de gauche – se sont mobilisées contre un capitalisme sauvage en misant sur la construction d’un État social consistant. Ce n’est pas la fin du monde et la social-démocratie s’est sans doute figée dans le temps, dans la période des Trente glorieuses (1945-1975) mais quand même! [1]
Deuxième idée reçue: l’économie capitaliste de marché occupe tout le terrain.
En fait et en principe la question n’est pas d’être pour ou contre une économie de marché mais de bien voir que l’« économie capitaliste de marché » domine sans occuper tout le terrain, que le modèle capitaliste de développement qui occupe de façon dominante cette économie de marché fait gravement problème sans pour autant tout accaparer. Dominant oui. Sans en faire une démonstration exhaustive ici, on peut très bien voir le façonnement de nos sociétés aujourd’hui par ce modèle dans plusieurs secteurs déterminants: dans le secteur agroalimentaire; dans celui des énergies fossiles et dans celui de la finance. Cependant, dans une majorité d’écrits et des débats sur l’économie coopérative et sociale au Québec que je connais bien, il y a deux tabous :
 a) l’hésitation à critiquer le modèle dans son ensemble et à le caractériser comme capitaliste. On préfère parler uniquement d’entreprises et dans ce cas d’«entreprises traditionnelles», ce qui ne veut rien dire. Sur ce qui change de ce côté-là, on lira avec profit le numéro de juin de la revue Vie économique dont l’intitulé est Le capitalisme en crise, quelle réponse des coopératives? Disponible gratuitement sur le site du blogue Oikos.
a) l’hésitation à critiquer le modèle dans son ensemble et à le caractériser comme capitaliste. On préfère parler uniquement d’entreprises et dans ce cas d’«entreprises traditionnelles», ce qui ne veut rien dire. Sur ce qui change de ce côté-là, on lira avec profit le numéro de juin de la revue Vie économique dont l’intitulé est Le capitalisme en crise, quelle réponse des coopératives? Disponible gratuitement sur le site du blogue Oikos.
b) l’action politique, souvent comprise au sens trop exclusif de plaidoyer exprimé par des manifestations de « quasi-désobéissance civile », empêche le mouvement coopératif et de l’économie sociale de s’introduire de diverses manières collectives dans le débat public sur des questions de société (à l’occasion d’élections par exemple). Il se réfugie dans la neutralité politique [2]. On se confine alors à faire du lobby d’organisation sectorielle – n’avançant que des demandes sectorielles – comme si la somme des demandes des divers groupes d’intérêt pouvait garantir l’intérêt général.
Heureusement cette manière de faire est de plus en plus remise en question si on pense à quelques mobilisations majeures des dernières années tels que la Conférence internationale du mouvement coopératif à Lévis en 2010 (Favreau et Molina 2011); la rencontre du «consortium» Caisse d’économie solidaire Desjardins/Fondaction/GESQ au Centre Saint-Pierre à Montréal et la participation québécoise aux Rencontres du Mont-Blanc (RMB) à Chamonix en 2011; celle du 26 avril 2012 à Joliette de même que le Sommet international des coopératives au début octobre [3].
L’ÉSS peut très bien revendiquer d’être une des voies de l’alternative au capitalisme (document d’orientation des Rencontres du Mont-Blanc de novembre 2011; Draperi, 2011; Jeantet, 2010). Et on peut très bien être contre le capitalisme et cohabiter avec des PME locales et régionales du secteur privé qui, la plupart du temps, sont assez fortement enracinées dans leur milieu et attachées à celui-ci.
Aux yeux des coopératives et de l’économie solidaire en général, le monde de l’entrepreneuriat est trop important pour être laissé à une poignée de grands actionnaires qui en dirigent les destinées et aux multinationales qui veulent monopoliser tout le terrain. Il y a nécessité d’un vaste secteur non capitaliste d’entreprises, la nécessité des syndicats pour introduire le minimum de démocratie dans les grandes entreprises et la grande utilité de disposer d’organisations de vigilance comme le MEDAC.
Historiquement, l’a-t-on oublié, la naissance de Desjardins a d’abord été une résistance au milieu banquier dit «traditionnel» qui refusait de prêter aux Canadiens-français (comme on disait à l’époque des Québécois). Historiquement, l’a-t-on oublié, les coopératives agricoles dans l’Ouest canadien résistaient aussi aux multinationales en formation dans le secteur agroalimentaire et soutenaient le développement d’un parti politique social-démocrate, la Cooperative Commonwealth Federation (CCF) devenue plus tard le NPD. Autre époque certes mais des pressions similaires ne s’exercent-elles pas aujourd’hui quand, par exemple, Wal-Mart, Target ou d’autres veulent s’emparer du commerce de détail dans les régions mettant du coup sur la défensive, par exemple, le réseau des quincailleries appartenant aux coopératives agricoles ou celles du petit commerce privé local.
Tout çà pour dire qu’il y a une économie de marché qui n’est pas automatiquement sous l’égide du modèle économique dominant. C’est le cas du commerce équitable ou de l’intercoopération dans le secteur agro-alimentaire (la jonction entre coopératives agricoles, stations d’essence Sonic, quincailleries Unimat, centres d’horticulture, etc…). C’est aussi le cas d’entreprises de caractère public comme Hydro-Québec ou la Caisse de dépôts qui ont une reddition de comptes publique et obligée.
Troisième idée reçue: tout ce qui est privé est capitaliste!
Il faut distinguer l’entreprise capitaliste de l’entreprise privée. La première est un mode d’exploitation du travail et des ressources réalisé par de grandes sociétés détenues par des actionnaires institutionnels disposant de grands moyens (Walmart est précisément de ce type). L’entreprise privée, par exemple une PME de type artisanal, commercial, agricole etc., appartient, comme la plupart des entreprises à propriété collective (coopératives, associations à vocation économique), à des systèmes marchands localisés qui se sont constituées la plupart du temps en marge du mode d’exploitation capitaliste, en occupant des créneaux délaissés ou jugés sans intérêt par ce mode d’exploitation. C’est ainsi que les agriculteurs (propriétaires de leur terre), les petits commerçants locaux (quincaillerie, boulangerie, salon de coiffure, boutiques de vêtements, etc.) et une bonne partie des travailleurs dits autonomes engagés dans le développement d’une petite entreprise font partie de cet univers de l’entreprise privée. Peut-on mettre çà dans le même registre que les multinationales ? Pas le moins du monde. Draperi avance cependant l’idée qu’«en l’absence d’une théorie de référence et d’une stratégie coopérative, la conception libérale menace nombre de coopératives, soit en les forçant à se banaliser dans le cadre d’un capitalisme conquérant, soit en les contraignant à occuper des niches et à les enfermer dans un rôle de régulation ou de réparation des problèmes inhérents au capitalisme» (Draperi, revue Vie économique, juin 2012).
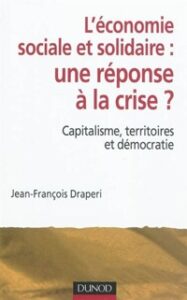 C’est la raison pour laquelle on ne peut se contenter de caractériser ces entreprises d’entreprises dites « traditionnelles ». Qu’est-ce que cela veut dire au juste «entreprises traditionnelles»? Première confusion que cela provoque : on met pêle-mêle des PME privées locales et régionales et des multinationales comme Alcan, British Petroleum, Wal-mart, Target, Monsanto ou autres. En termes de développement économique et social, font-ils la même chose? Pas du tout! Les premières sont très sensibles aux communautés dans lesquelles elles sont implantées, se refusent souvent à la délocalisation, etc. Les secondes ne s’intéressent pas du tout à cet environnement, se délocalisent volontiers dans des pays qui ont une main d’oeuvre à bon marché, recherchent la prise de contrôle de toute la filière pour ultimement imposer leurs prix, etc. Cas typique de l’agriculture mondiale comme l’illustre très bien l’encart suivant :
C’est la raison pour laquelle on ne peut se contenter de caractériser ces entreprises d’entreprises dites « traditionnelles ». Qu’est-ce que cela veut dire au juste «entreprises traditionnelles»? Première confusion que cela provoque : on met pêle-mêle des PME privées locales et régionales et des multinationales comme Alcan, British Petroleum, Wal-mart, Target, Monsanto ou autres. En termes de développement économique et social, font-ils la même chose? Pas du tout! Les premières sont très sensibles aux communautés dans lesquelles elles sont implantées, se refusent souvent à la délocalisation, etc. Les secondes ne s’intéressent pas du tout à cet environnement, se délocalisent volontiers dans des pays qui ont une main d’oeuvre à bon marché, recherchent la prise de contrôle de toute la filière pour ultimement imposer leurs prix, etc. Cas typique de l’agriculture mondiale comme l’illustre très bien l’encart suivant :
| Au Nord et encore plus au Sud, l’enjeu de la souveraineté alimentaire est ainsi revenu à l’avant-scène internationale. Cela tient au fait que l’agriculture et la filière alimentaire subissent, tendanciellement, le même traitement industriel et financier que les autres activités économiques : de grandes firmes multinationales pour assurer l’agrofourniture (Monsanto, Bunge, Sugenta, ADM, Dupont, etc,) ; de grandes firmes multinationales pour la transformation agroalimentaire (Nestlé, Coca-Cola, General Mills, Kraft Foods, Unilever, Smithfield Food, etc.) ; de grandes firmes multinationales pour la grande distribution de masse (Walmart, Carrefour, Tesco, Metro Group, etc.) dans un marché de plus en plus international mais avec peu de protections…La question est bien posée par Michel Griffon, spécialiste international en matière d’agriculture (Griffon 2006). Il était aux RMB dans un atelier sur les agricultures et le développement durable : « Il y a de 20 à 25 millions d’exploitations dans le monde, qui font de l’agriculture industriellement intensive, ce qui représentent 30 à 40% de la production mondiale. Mais cette exploitation vit présentement une hausse des coûts de l’énergie, génère beaucoup de gaz à effet de serre, est dommage pour la biodiversité et entre dans une phase de rareté » en ce qui a trait aux engrais (dont une bonne partie dépend du pétrole) et à l’eau (étant donné le changement climatique). La demande pour plus de viande ne fait qu’accentuer les besoins en terres (production de maïs et de soya) pour alimenter le bétail. C’est notamment le problème de la Chine. Si, de plus, on va vers les agrocarburants parce que l’agriculture et la forêt sont les candidats au remplacement du pétrole, on voit tout de suite se profiler le cercle vicieux. « Puis il y a deux milliards 400 millions de petits exploitants peu mécanisés, ne disposant pas d’un régime sanitaire adéquat, peu productive et dont l’enjeu est d’accroître leurs rendements » avec, en autant que faire se peut, des techniques dont les coûts seraient faibles et une production respectant l’environnement afin de rendre les terres plus fertiles. Griffon ne s’en cachait pas, l’équation est très très difficile à résoudre.
|
Le problème d’une partie de l’économie coopérative et solidaire, c’est qu’elle est souvent tournée vers elle-même, qu’elle n’a pas d’analyse de l’économie en général et de son insertion dans celle-ci. Draperi a raison : cela les met à risque d’être à la merci d’une conception libérale et en dernière instance les met à risque de banalisation. En se contentant souvent de lieux communs comme «les entreprises traditionnelles». C’est la prise de conscience de l’ampleur de la crise actuelle qui lui a fait saisir – ce n’est qu’un début – cette limitation. Ceci étant, il faut aussi prendre une distance critique à l’égard de la langue administrative courante des sciences de la gestion qui vient dépolitiser tous les enjeux économiques : « bonne gouvernance », « performance », « gagnant-gagnant », « gestion de crise », etc. sont des notions qui font son fonds de commerce. « Performance » plutôt que « viabilité économique » et « capacité d’action collective »; « bonne gouvernance » plutôt que « vie démocratique d’entreprise »; « entreprises traditionnelles » plutôt qu’entreprises privées et entreprises capitalistes; « gestion de crise » plutôt que « négociation » et « délibération », etc. Il n’y a pas de mots innocents, ils ont toujours un sens qu’il faut décoder.
Quatrième idée reçue : les multinationales dans l’ordre économique mondial capturent tout
La notion d’« économie plurielle » est devenue une notion de référence qui a eu tendance à effacer celle de « modèle économique dominant ». La notion d’économie plurielle a de la pertinence (pour démontrer qu’il n’y a pas qu’une économie capitaliste de marché) mais elle escamote malheureusement le débat sur la prédominance de la logique capitaliste au sein du dit marché. C’est une « notion molle » nous disait Danièle Demoustier à un séminaire qui avait précédé la conférence internationale de Lévis (septembre 2010). C’est aussi une notion « gentille ». La question qui fâche : peut-on parler d’« économie plurielle » sans parler de « modèle économique dominant » et donc d’une tendance lourde à la « monoculture » pour signifier la perte de « biodiversité » de l’économie et pour bien réfléchir sur le capitalisme d’aujourd’hui – qu’on doit aussi bien nommé – soit un capitalisme financier et boursier qui a provoqué la première crise socioécologique de nos sociétés (Gadrey, 2010). On l’a dit ailleurs : la crise de 2008 était aussi alimentaire, énergétique et climatique. Et ce sont les multinationales au premier chef qui nous y ont précipité.
À notre avis l’examen qui est à faire maintenant a trait à cette prédominance de l’économie capitaliste de marché sur les autres modes d’organisation de l’économie (entreprises collectives et publiques). Et la réflexion doit aussi porter sur la façon de se défaire de sa domination économique qui est aussi politique: a) les transferts d’autorité vers l’expertise privée, qui prennent diverses formes notamment à l’OMC; b) l’influence informelle des grandes multinationales sur les grandes agences de l’ONU et sur les États par l’intermédiaire de Forums économiques mondiaux; c) l’intervention obligée des États dans la résolution de la crise des grandes banques (la faillite des banques, c’était aussi la faillite des épargnants!) dont le prix à payer a été la montée en flèche de la dette publique, montée pilotée par les agences de notation (Graz, 2011 : 75-85). Faut-il se surprendre que les institutions financières coopératives soient en furie. En clair, vous avez ici une des origines du [Sommet international des coopératives organisé cet automne en collaboration avec l’Alliance coopérative internationale (ACI)->http://www.oikosblogue.coop/?p=13008]. Il y a un rapport de force qu’on le veuille ou pas: celui qui existe et qui nous défavorise. Et il y en a un autre qui est à construire…À la condition de délaisser la neutralité politique.
Cinquième idée reçue : avec le temps, le capitalisme a pris un « visage humain »
Dans un ouvrage récent, le chef de la Banque de Montréal au Québec, L.Jacques Ménard, nous fait découvrir un capitalisme à visage humain à travers des figures de réussite (Ménard, 2011, Aller au bout de ses rêves, VLB). Louis Cornellier dans une critique de cet ouvrage dans le journal Le Devoir décortique bien l’argumentation : chercher les Lise Payette, Gérald Larose, Claude Béland…Ici on est submergé par des gens qui sont supposément aller « au bout de leurs rêves » en « se dépassant », en « prenant des risques », en « travaillant très fort » (Jean Béliveau). On lit que Mgr Turcotte affirme que la « compétition, c’est la vie même », Julie Payette dit qu’il vaut mieux « investir dans la recherche que dans les programmes sociaux », Jean Coutu, que « c’est la passion qui compte pour réussir » et Robert Charlebois, que « la meilleure façon d’aider son peuple, c’est de s’enrichir individuellement ». Louis Cornellier a l’art de dépecer un texte (formation en philosophie oblige!).
Aujourd’hui, la mondialisation néolibérale est faite en premier lieu d’un important secteur du patronat qui roule dans le capitalisme sauvage : par exemple les minières canadiennes dans les pays du Sud (exploitation de la main d’oeuvre et pollution des rivières) ; les gazières américaines (la destruction des écosystèmes par l’exploitation de 500,000 puits de gaz de schiste dans 37 états) ; les pétrolières et les constructeurs automobile (source majeure de gaz à effet de serre et donc de réchauffement climatique) etc.
Et il y a un secteur plus libéral dont certaines composantes s’engagent dans des activités dites philanthropiques en créant des fondations notamment dans les nouvelles technologies des communications (la Fondation Gates-Buffet aux É.U., la Fondation Chagnon au Québec…). C’est ce que certains nomment le « compassionate capitalism », le capitalisme compatissant. Louis Cornellier dans sa critique du livre de Ménard s’empresse donc d’ajouter que le problème n’est pas d’augmenter la richesse nationale (obsession unidimensionnelle des entreprises capitalistes) mais de voir des «banquiers engranger des profits records sur le dos de leurs simples clients et de multiplier les abris fiscaux pour leurs gros clients». Bref un peu plus de justice sociale dans notre projet de société permettrait de ne pas compter surtout sur la générosité des parvenus nous dit-il.
Autrement dit la première critique qu’on peut faire a trait au fait qu’une poignée d’individus issus du milieu des affaires puissent s’arroger la liberté de choisir les projets sociaux jugés les plus pertinents parmi les milliers de projets d’organisations qui leur sont présentés et qui sont d’ailleurs placées en concurrence pour ce faire. En fait ce type de fondation remplace purement et simplement l’État ou un groupe d’États dans la distribution de la richesse. Des intérêts purement privés responsables de l’intérêt général…
Voici donc un premier billet autour de cinq idées reçues concernant le capitalisme. Le prochain billet portera sur cinq autres idées reçues. Parmi elles, l’idée du « 1%-99% » du mouvement des Indignés, celle sur la mainmise supposée du capitalisme en matière d’économie verte, celle du ou des capitalismes… Suite du billet
Pour en savoir plus
Bourque, G., L.Favreau et E. Molina (2012), Le capitalisme en crise. Quelle réponse des coopératives ? Revue Vie économique, vol.3, numéro 4, Éditions Vie économique, coopérative de solidarité, Montréal.
Draperi, J-F. (2011), L’économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ? Capitalisme, territoires et démocratie. Éditions Dunod.
Favreau, L . et M. Hébert (2012), La transition écologique de l’économie. Contribution des coopératives et de l’économie solidaire. PUQ, Sainte-Foy.
Favreau, L. et E. Molina (2011), Économie et société, pistes de sortie de crise, PUQ, Sainte-Foy.
Gadrey, J. (2010), Adieu à la croissance. Bien vivre dans un monde solidaire. Éd. Les petits Matins/Alternatives économiques, Paris.
Graz, J-C (2011). « La toute-puissance des acteurs privés dans l’ordre économique international » dans B. Badie et D. Vidal, Nouveaux acteurs, nouvelle donne. L’état du monde 2012, La Découverte, p.75 à 85.
Lipietz, A. (2012), Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste, Éd. La Découverte, Paris.
[1] Ici au Québec un collectif a ouvert un chantier pour une social-démocratie renouvelée. On peut retrouver un certain nombre d’idées-clés de ce courant dans le numéro suivant de la revue Vie économique. On y notera un texte de ma part (hors thème) où, tout en saluant cette initiative, je prenais mes distances sur deux ou trois points que je considérais comme majeurs : l’absence de critique des partenariats développés au Québec depuis plus d’une décennie ; la faible présence de la dimension internationale dans le projet (notamment la coopération Nord-Sud) et surtout la quasi-absence de réponse à l’urgence écologique.
[2] Le mouvement coopératif (et de l’économie sociale en général) n’est d’ailleurs pas le seul à être timide sur ce terrain. L’élection au Québec de septembre dernier en a été la plus belle démonstration. Mis à part les groupes écologistes qui l’ont prise très au sérieux de même que les associations étudiantes qui étaient déjà fortement mobilisées, les organisations syndicales, les organisations communautaires tout comme les organisations coopératives et les groupes de femmes n’ont pas dit un mot. Au lendemain des élections aussi. Pendant que les organisations de représentation politique du secteur privé, et tout particulièrement les Chambres de commerce, ne se privaient pas de jouer les alarmistes face aux nouvelles mesures fiscales (et autres) du gouvernement Marois. Cherchez l’erreur !
[3] Voir à cet effet le cahier spécial du Devoir du 15 octobre 2011 et celui du 21 avril 2012, tous deux disponibles en page d’accueil du site du GESQ. Voir aussi sur le blogue Oikos plusieurs courts articles utiles à cet égard : a) sur le Québec et les RMB ; b) sur le rendez-vous solidaire de Joliette ; c) sur le Sommet des coopératives.
Louis Favreau
Articles de cet auteur
- Solidarité internationale en temps de pandémie : pompiers de service ou architectes du développement ?
- Développement économique local dans les pays du Sud : l’avenir des services énergétiques
- Solidarité internationale et développement des communautés à l’heure de l’urgence climatique
- Agriculture au Québec et dans le monde : la transition sociale-écologique est déjà là !
- Le modèle progressiste à venir sera-t-il social-démocrate ou social-écologique ?

