On ne bâtit pas des alternatives au modèle économique dominant sans saisir la nature de la crise et les fondamentaux de l’économie dominante d’aujourd’hui. Quand un diagnostic est approximatif, les remèdes proposés risquent de l’être également. Il faut donc cerner de plus près l’organisation économique et sociale qui est la nôtre que certains nomment pudiquement une économie de marché et d’autres, de plus en plus nombreux, qui n’hésitent plus à nommer un chat un chat : le capitalisme. Suite du billet précédent
Sixième idée reçue : 1% de super-riches et 99% de gens exploités
Le 1%-99% des Indignés est une image forte mais elle est une fausse bonne idée. Le 1% de riches et le 99% restants, c’est une image forte mais c’est la négation de l’existence des classes sociales : classes dirigeantes (pas que 1%), classes moyennes qui travaillent (majoritaires dans une société comme la nôtre et en plein développement dans les pays émergents) et classes populaires (dont certains groupes dans nos sociétés vivent une forte précarité et même l’exclusion). Ainsi mis à part l’imaginaire qui lui correspond, en termes d’analyse, c’est nul et çà nous empêche de bien comprendre nos sociétés…et donc de développer des mobilisations plus efficaces et structurantes. Pourquoi est-ce une idée reçue?
Ne nous comptons pas fleurette, malgré cette crise sans fin qui affecte beaucoup de monde, le temps actuel est néanmoins le temps des riches comme le démontre Thierry Pech dans son ouvrage Le temps des riches. Anatomie d’une sécession, (2011, Seuil). Derrière cette image, il y a une question qui vient et c’est celle-ci: mais comment donc avons-nous laissé les riches devenir de plus en plus riches? On a beau dénoncer les dégâts sociaux et environnementaux du capitalisme boursier et financier, la dictature d’une mi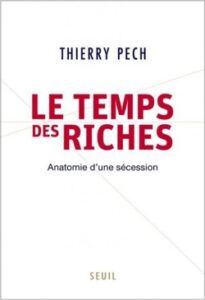 norité d’actionnaires s’imposant dans bon nombre d’entreprises majeures, ou la stagnation du pouvoir d’achat des salariés, la mobilisation (celle des mouvements, des partis et des États) contre ce capitalisme sauvage n’est pas encore très forte.
norité d’actionnaires s’imposant dans bon nombre d’entreprises majeures, ou la stagnation du pouvoir d’achat des salariés, la mobilisation (celle des mouvements, des partis et des États) contre ce capitalisme sauvage n’est pas encore très forte.
La première raison a évidemment trait au relâchement généralisé de la fiscalité à l’égard des riches : le développement de gains sans aucun frein est socialement devenu acceptable sous l’égide de ce capitalisme international où la finance a pris les postes de commande. La seconde raison a trait à la légitimité obtenue grâce à la diffusion par les milieux financiers et leurs relais politiques de l’idée que la richesse vient avec des entrepreneurs de premier plan et que la richesse accumulée par cette minorité au haut de la pyramide finit toujours par retomber sur les strates inférieures. La réussite personnelle et la compétition érigées en religion sont devenues tout à coup les grands moteurs de la richesse nationale. Comme si l’État et les collectivités n’y étaient pour rien dans la création de richesse. Comme si les travailleurs n’y étaient pour rien. Cherchez l’erreur!
Avec la seconde raison est venu le fait que le syndicalisme, mouvement majeur de la période antérieure (1945-1975) a été considérablement affaibli dans les 30 dernières années. Le travail est devenu de plus en plus précaire et le syndicalisme en partie impuissant face à cette progression de la précarité. Ce faisant, la syndicalisation est devenue beaucoup plus difficile. Et la mobilisation qui l’accompagne pour aller chercher un meilleur pouvoir d’achat, par l’augmentation des salaires mais aussi par toutes sortes de mesures de protection sociale, s’est considérablement affaissée. Résultat, le syndicalisme n’est plus perçu comme un garant de progrès social par delà les groupes syndiqués eux-mêmes.
Cette dynamique est aussi aisément liée à un autre facteur plus dur à avaler pour les courants progressistes : c’est la tolérance sociale croissante au sein des classes moyennes et populaires à l’égard de l’enrichissement. Par l’autre bout de la lorgnette, c’est le délitement de la culture égalitaire et l’idée que les impôts ne sont pas là pour offrir des services publics de qualité mais pour limiter les libertés individuelles. Bref, nous dit Thierry Pech, directeur de rédaction de la revue Alternatives économiques, il y a «une certaine ambivalence à l’égard de l’argent chez les gens qui en ont peu, un mélange de fascination et d’envie». Sans compter la montée en puissance de l’idée devenue primordiale de la réussite individuelle.
Septième idée reçue : il n’y a qu’un capitalisme.
La science économique est relativement aveugle. Elle n’enseigne pas le pluralisme. Elle considère par exemple qu’il n’y a qu’une explication au chômage. Or il convient, comme nous y invitent les théories de l’École de la régulation, d’étudier les différents types de capitalisme afin de ne pas verser dans le fourre-tout. C’est le modèle économique fortement dominant dans nombre de sociétés avec comme figure de proue les États-Unis mais ce n’est pas le cas des pays scandinaves où les coopératives et les syndicats sont puissants, l’intervention de l’État majeure et le service public considéré comme nécessaire et légitime par la très grande majorité des citoyens. Bref, on n’est pas tout à fait sur la même planète. Il n’y a peut-être pas un capitalisme mais des capitalismes. Explication.
Nombre de mouvements sociaux et le mouvement altermondialiste à sa suite tiennent sur le capitalisme un discours au singulier et résume la situation en bout de ligne en positionnant les choses de façon bipolaire : réforme ou révolution ? Dans la gauche sociale québécoise, on partage spontanément cette idée sans trop en débattre. Mais est-ce exact qu’il n’y a qu’un capitalisme et que le seul choix, soit celui du «tout ou rien»? Dans la foulée de ce qui est avancé dans le premier point, nous dirions que non : il n’y a pas un seul capitalisme mais des capitalismes affirme d’entrée de jeu le politologue Généreux (1999). Le politologue canadien Hall et son collègue Soskice le confirment en démontrant dans leur ouvrage qu’il existe bel et bien une variété de capitalismes (Hall et Soskice, 2001). Leur ouvrage fait la distinction entre les «économies de marché libérales» où les relations de marché concurrentielles prévalent et les «économies de marché coordonnées» où l’accent est davantage mis sur les institutions publiques de régulation. Ces dernières étant celles auxquelles nous faisons référence lorsqu’il s’agit du déploiement de l’État social dans son sens le plus fort : intervention plus marquée de l’État dans l’organisation de la société, présence active de la société civile (syndicats, ouvriers et paysans, entreprises à propriété collective, mouvement associatif et coopératif, mouvement des femmes…), extension continue du champ des politiques publiques en matière d’environnement, de santé, etc.
Bref, c’est l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et la France par rapport aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande par exemple. Autrement dit, au 20e siècle, dans les pays du Nord, dans les rapports de force entre le monde capitaliste et le mouvement ouvrier, les mouvements sociaux, par leurs luttes, en sont arrivés à «civiliser le capital» en quelque sorte mais à des degrés fort divers [1]. D’où par exemple que dans une société donnée, l’État peut peser pour 50 % du PIB ou pour 30 %. Différence majeure parce que la logique du non-marchand occupe une place beaucoup plus importante dans le cas des «économies de marché coordonnées» que dans l’autre. Type d’économie dont se rapproche le plus le Québec en Amérique du Nord : Au Québec, l’État pèse pour 48,6 % (au Canada pour 42,8 %) car il intervient fortement dans l’éducation, la santé, les services sociaux, l’accès aux médicaments… Sans compter que nous disposons d’un régime public de retraite (géré par la Caisse de dépôts) et, avec Hydro-Québec d’une entreprise publique ayant favorisé l’équité territoriale en matière d’énergie pour toutes les régions de même qu’un régime fiscal favorisant la diminution des écarts entre les ménages [2].
La pression des mouvements sociaux organisés a fait historiquement ses preuves. Notons entre autre que le volume de l’État ne pesait que pour 10 % du PIB au début du 20e siècle, pour 30 % au début des années 50 et pour plus ou moins 50 % dans un certain nombre de pays (ceux à économie de marché coordonnée) au début du 21e siècle. Cette pression a notamment fait ses preuves dans les pays scandinaves où les dépenses courantes des administrations publiques comptent pour 55,3 % contre 32,7 % pour les États-Unis. La différence est énorme : autrement dit, le rôle de l’État joue pour plus de la moitié du PIB dans un cas et pour moins d’un tiers dans l’autre, laissant notamment sur la brèche, dans le cas américain, plus de 40 millions de leurs citoyens fragilisés dans leur patrimoine familial par l’absence d’un service public véritablement universel en matière de santé et de services sociaux [3]. Ce n’est pas un hasard : aux États-Unis, le service public y est minimal, le syndicalisme y est généralement faible, le mouvement associatif en partie sous tutelle des Églises de droite et les entreprises de propriété publique ou collective englouties par la force des multinationales.
Ce qui veut dire qu’une grande partie de l’activité économique de nos sociétés peut échapper à la stricte logique marchande (près de la moitié dans le cas du Québec), ce qui les rend d’ailleurs moins vulnérables en tant de crise. La «biodiversité» a ses vertus. Et en dépit du discours néolibéral, la part des impôts progresse partout dans les pays de l’OCDE, c’est-à-dire le non-marchand : ces prélèvements obligatoires ont passé en moyenne de 31 % à 37,3 % du PIB entre 1975 et 2000 (Duval, 2003 : 22) [4]. Certes l’État se désengage mais il le fait surtout au plan économique (privatisation d’entreprises publiques par exemple). Au plan social, il n’a de cesse d’élargir ses champs d’intervention [5].
Huitième idée reçue : le capitalisme est là pour rester.
C’est à l’économie capitaliste de marché et à sa domination qu’on réfère généralement lorsqu’on dit que «le capitalisme est là pour rester». Or cette domination n’est pas obligatoirement appelée à demeurer comme tendent à le démontrer périodiquement certaines sociétés souvent nettement plus progressistes que d’autres. La comparaison entre les É.U. et les pays scandinaves, aujourd’hui comme hier, en fait foi.
L’économie est une construction sociale. Elle opère grâce à des institutions qui ont été créées dans un cadre juridique et politique que nous pouvons contrôler, institutions qui sont elles-mêmes le fruit de compromis entre groupes d’une même société. C’est ainsi qu’il est possible de parler d’un «modèle québécois de développement» lorsque nous parlons de cette phase de développement de l’affirmation économique nationale qui, dans les années 60, a permis un développement sans précédent d’une institution financière coopérative forte (Desjardins), d’une puissante institution financière publique (la Caisse de dépôts), et d’une société d’État d’énergie hydroélectrique (Hydro-Québec) pour ne nommer que celles-là.
Ainsi, contrairement à ce que nombre de nos dirigeants prétendent, nous avons le choix et dans le cas précité, nous avons déjà fait ce choix (dans les années 1960 et 1970) d’une économie publique, coopérative, mutualiste, sociale plus forte favorisant une plus grande «biodiversité économique» . Les voies sont alors multiples car il y a plusieurs modèles économiques qui cohabitent (et sont en concurrence) dans une même société : une «économie capitaliste de marché» pour reprendre la notion utilisée par Ricardo Petrella, celle qui est inscrite dans une logique de profit maximum (dominante) ; une économie publique (pas uniquement pilotée par la logique du profit) qui prend une place très importante dans certaines sociétés (pays d’Europe du Nord et Québec/Canada versus les E-U par exemple) ; une économie d’entreprises à propriété collective (coopératives, mutuelles, associations à vocation économique).
 Et plus il y a biodiversité de l’économie et cohabitation active entre les différents modèles, plus les chances d’une société plus juste existent. Il y a aujourd’hui des choix que nous pourrions faire dans la voix déjà empruntée dans les années 1960-1970 : l’utilisation aujourd’hui de la société d’État Ressources Québec comme levier de création de filières opérationnelles d’exploitation et de transformation des métaux stratégiques que le Québec possède permet d’aller dans cette direction [comme le démontre si bien l’économiste de l’IREC Gilles Bourque de même que le projet de monorail électrique interurbain et interrégional avancé par le même institut (par les chercheurs Bourque et Laplante) et récemment repris par le gouvernement Marois.
Et plus il y a biodiversité de l’économie et cohabitation active entre les différents modèles, plus les chances d’une société plus juste existent. Il y a aujourd’hui des choix que nous pourrions faire dans la voix déjà empruntée dans les années 1960-1970 : l’utilisation aujourd’hui de la société d’État Ressources Québec comme levier de création de filières opérationnelles d’exploitation et de transformation des métaux stratégiques que le Québec possède permet d’aller dans cette direction [comme le démontre si bien l’économiste de l’IREC Gilles Bourque de même que le projet de monorail électrique interurbain et interrégional avancé par le même institut (par les chercheurs Bourque et Laplante) et récemment repris par le gouvernement Marois.
L’économie est un des fondements de nos sociétés, elle fait partie de notre mode d’organisation sociale. Ce n’est pas accessoire ou secondaire dans la lutte pour la justice sociale. Pourquoi je te dis çà ? Parce qu’il faut caractériser plus clairement notre économie – l’utilisation de la notion d’économie plurielle est insuffisante – en pointant l’économie capitaliste de marché ou, plus largement, le modèle dominant qui est un modèle capitaliste de développement. Mais en sachant cependant que nous pouvons oeuvrer dès maintenant au développement d’une autre économie. L’économie capitaliste de marché, après les 30 glorieuses qui avait permis la montée d’un État social des années 1945 à 1975 et donc d’entreprises publiques, d’entreprises collectives et de multiples régulations de l’État, a certes eu tendance à reprendre du collier et à s’imposer de plus en plus dans nos sociétés à la faveur de la mondialisation néolibérale que nous avons connu avec son cortège de dérégulations. Mais cela n’est pas une fatalité.
Je constate souvent que, dans certaines organisations, on n’a de cesse d’opposer l’«économique» et le «social» comme si une société juste socialement ne reposait pas sur une économie solide. Or c’est possible d’avoir une économie solide appuyée fortement par la «biodiversité» : des municipalités actives au plan économique, des entreprises publiques fortes, un mouvement coopératif contrôlant des secteurs entiers comme les coopératives sociales italiennes le font depuis 30 ans dans le secteur des services de proximité ou comme les coopératives agricoles québécoises l’ont historiquement réussi en ne se faisant pas avaler par les multinationales de l’agroalimentaire.
Bref, les responsables de la crise, ce n’est pas toute l’économie mais l’économie capitaliste de marché. Et aujourd’hui cette économie capitaliste de marché est celle d’un capitalisme néolibéral boursier et financier, celle de grandes multinationales, tout particulièrement pas les temps qui courent les banques privées, les pétrolières/gazières/minières/constructeurs d’automobiles de ce monde (américaines, européennes et chinoises aussi), les agences de notation….
Neuvième idée reçue : le capitalisme d’hier et d’aujourd’hui, c’est du pareil au même !
Dans une certaine gauche, le capitalisme, partout et dans toutes les époques, c’est du pareil au même. Une telle affirmation nous épargne de faire de nouvelles analyses. C’est de la paresse intellectuelle. Il y a des périodes. Celle que nous traversons est celle d’un capitalisme boursier et financier adossé à une crise écologique. Depuis, grosso modo 20 à 30 ans. Si le capitalisme en général peut se définir comme un rapport social fondé sur la propriété privée des moyens de production et de distribution et que cette appropriation aboutit à une course sans fin de conquête d’un profit qu’on veut maximum, il demeure qu’une telle définition est un peu désincarnée. Pour y voir clair, il faut faire intervenir deux variables : sa genèse ou son histoire et ses variétés.
Nous avons abordé ce dernier point de la variété dans la septième idée reçue, celle qui nie qu’il y a des capitalismes. Mais la périodisation de ce dernier est également importante : le rapport de force n’est pas toujours le même. Pour faire court, le capitalisme commercial et les conquêtes coloniales ont constitué une première grande phase de développement. La valeur d’usage y était le but premier de l’activité productive. Par la suite, nous avons assisté à la révolution industrielle (18 et 19e siècles), à la période des manufactures adossée au développement des énergies fossiles et, en premier lieu, au charbon, révolution industrielle qui fait émerger une nouvelle classe, la classe ouvrière, comme force de travail. Simultanément, nous avons vu émerger l’essor des banques soutenues par l’État.
Ce capitalisme industriel nous conduira à l’aube de la deuxième guerre mondiale (1945-1975) où le compromis entre le mouvement ouvrier et une partie du grand capital (Ford et autres multinationales) jouera en faveur du premier comme du deuxième : transformation de la condition sociale des classes populaires globalement marginalisées et développement de grandes entreprises qui acceptent une législation du travail, des protections sociales publiques, etc. C’est à partir de la fin des années 1970 jusqu’à aujourd’hui que ce compromis social s’effrite et que la crise écologique annonce des dégâts majeurs (rapport sur la croissance de 1972). Le défi d’aujourd’hui n’est plus le même qu’il y a 30 ans : le capitalisme est actionnarial et il est fortement destructeur des écosystèmes. Sa capacité de progrès social et de réponse à l’urgence écologique est beaucoup plus limitée. Il faut donc trouver autre chose : une autre façon de vivre en société, une transition écologique de l’économie et une démarchandisation des biens considérés comme communs (l’eau, la terre…) sont à mettre en oeuvre.
Dixième idée reçue : l’économie verte n’est que du capitalisme vert

Pour faire court en quelques points, je retiens ceci :
- Les grandes multinationales du pétrole et du gaz (y compris le gaz de schiste), en fait les entreprises productrices de toutes les énergies fossiles, ne veulent rien savoir de l’«économie verte» parce que cela risque fort de réduire considérablement leur place dans le modèle de développement à venir qui sera un modèle à énergies renouvelables, un modèle qui cherchera en permanence à obtenir l’indépendance énergétique à l’égard des énergies fossiles.
- C’est pour çà qu’elles ont fait pression sur Rio+20 parce que l’économie verte s’inspire directement des documents du PNUE (voir mon billet précédent à ce propos), lesquels les conteste de front.
- Cette question de l’existence d’un capitalisme vert qui énerve tant une certaine gauche traduit cependant qu’il existe un rapport de forces mondial : entre, d’une part, de grandes multinationales (et des États pétroliers dont le Canada) et, d’autre part, des mouvements (notamment le mouvement syndical international), des gouvernements locaux (municipalités) [6], certains États et même certaines grandes entreprises du secteur privé ou du secteur public. On peut penser par exemple à Bombardier et son intérêt pour le projet de monorail électrique interurbain de même qu’à Hydro-Québec; à l’allemande Siemens, chargée initialement de construire 17 centrales nucléaires dans le pays, qui annonce en 2011 qu’elle quitte définitivement ce secteur après la catastrophe de Fukushima pour se renforcer dans les énergies renouvelables (journal Le Monde du 18 septembre 2011) ; au groupe allemand Bosch à Lyon qui a accepté la conversion de sa production de moteurs diesel en usine de panneaux solaires suite à une mobilisation syndicale et une proposition négociée dans ce sens (Favreau et Hébert, 2012 : 79-82).
Bref, il y a un capitalisme vert mais il est relativement marginal. Il est dans les énergies renouvelables (éolien, solaire…comme Innergex au Québec) mais plus que l’autre il est sous haute surveillance…mais peut faire des choses que d’autres acteurs engagés plus profondément dans le processus d’une économie plus écologique ne font pas ou ne pourraient faire. Par ailleurs, la «société dite civile» n’est pas un bloc homogène: il y a débat au sein de cette société civile internationale, non pas sur la conversion écologique de l’économie mais sur la manière de le faire. La proposition générale de mon billet précédent sur ce sujet était qu’il faut promouvoir des alternatives et simultanément revendiquer un encadrement (du local à l’international) des investissements de l’économie verte. Il est en effet mal aisé de raisonner dans «le tout ou rien», c’est-à-dire à partir d’une économie capitaliste de marché ayant une emprise totale sur la société, bref une économie dans laquelle il y a pas de «biodiversité économique» possible ni d’intervention d’États soutenant une croissance plus rapide du secteur apte à produire des énergies autres que fossiles, secteur plus souvent qu’autrement mixte où le privé, le public et le collectif s’entremêlent.
On peut aussi ajouter que la conversion écologique de l’économie ne va pas se faire par les seules alternatives locales (que certaines organisations sociales survalorisent avec une assez grande naïveté). Les communautés locales ont leur capacité d’influencer les choses mais les gouvernements locaux, les États, les grands mouvements et les institutions internationales (PNUD, PNUE, OIT, OMS…) ont beaucoup à voir là-dedans parce qu’il y s’agit bien là d’un enjeu international et d’un rapport de forces mondial.
D’autre part, il faut retenir que : 1) le débat autour de la notion d’«économie verte» est un débat autour d’une notion émergente ; 2) le débat est récent et on risque d’y voir un peu plus clair avec le temps ; 3) l’économie verte ne se confond pas avec le capitalisme vert: de nombreuses initiatives de coopératives et de l’ÉSS en général sont soutenues et accréditées, au plan politique national et international, par des organisations comme le FIDESS (l’association des Rencontres du Mont-Blanc) ; 4) on peut même envisager travailler avec l’entreprise privée qui est dans l’économie verte {car proclamer que l’écologie est incompatible avec le capitalisme signifie se résigner à ne rien faire. Le Green Deal ne se fera pas avec les seuls syndicalistes d’EDF et de Véolia [7], mais aussi avec la technostructure d’EDF et de Véolia. Ici, il convient de clarifier un peu la bordée des invectives écologistes contre le «capitalisme vert» (voir l’économiste et écologiste français Alain Lipietz, billet de blogue du 15 juillet 2012).
En guise de conclusion
Se mobiliser pour sortir du capitalisme et tout faire démocratiquement pour le dépasser.
Au début du premier billet sur ce thème, nous avancions qu’il fallait s’attaquer à la question des fondements de ce capitalisme en nous donnant trois repères : en premier lieu, le capitalisme a une vision de la société qu’on peut résumer par la formule du «tout au marché», c’est-à-dire que le marché est la clé principal de tous nos problèmes. En deuxième lieu, la domination de ce type d’économie est centrée sur une seule et unique logique, la logique du profit maximum, et tout particulièrement sur les grands secteurs stratégiques. Représentante type de cette économie : la firme multinationale. Secteurs stratégiques actuels : la finance, les pétrolières et les gazières, les minières, les constructeurs automobile, les agroalimentaires. En troisième lieu, le capitalisme a une emprise sur la société : il recherche tendanciellement une société régie par le marché c’est-à-dire avoir de l’emprise sur l’État (par ses lobbies) et les partis politiques (en les finançant), sur le système d’éducation et de santé (mode de gestion), les médias d’information (dont ils sont souvent les principaux actionnaires et publicitaires), les universités, les biens considérés comme des biens communs (accaparement privé de l’eau, de la terre…).
Une première conclusion à ce chapitre s’impose à partir du premier repère : il y a une bataille d’idées à mener. Si on est d’accord avec le second repère, l’autre conclusion est qu’il faut livrer bataille pour la biodiversité de l’économie et sa démocratisation. Et si on est d’accord avec le troisième repère, la conclusion est le défi démocratique, c’est-à-dire la promotion de l’autonomie de l’État, de l’indépendance des universités; de la socialisation des biens communs.
 Si par ailleurs on admet qu’il n’y a pas un seul capitalisme mais des capitalismes parce qu’il y a des différences sociales, économiques et politiques notables entre un pays comme le Danemark ou un pays comme les États-Unis; si, en second lieu, on considère que le seul projet qui se soit présenté comme l’Alternative, le modèle communiste, a échoué autant en URSS que dans les pays du Sud comme la Chine, Cuba ou le Vietnam, il faut aussi conclure à quelque part qu’il n’y a pas une seule Alternative globale mais bien des alternatives globales qui diffèrent selon le contexte : pays du Nord ou du Sud, régions bien dotées en ressources naturelles ou pas, régime démocratique et progressiste ou régime autoritaire, société civile mobilisée fortement ou pas…. Car la logique du «tout ou rien», du capitalisme unique ou de l’Alternative au capitalisme, avec un grand A est historiquement erronée au plan du diagnostic en plus de nourrir l’impuissance, l’immobilisme ou la seule stratégie du refus. En revanche, la logique des alternatives nourrit des possibles, introduit des choix politiques et donc crée des espaces pour remettre en question les rapports de domination et favoriser des changements sociaux en profondeur.
Si par ailleurs on admet qu’il n’y a pas un seul capitalisme mais des capitalismes parce qu’il y a des différences sociales, économiques et politiques notables entre un pays comme le Danemark ou un pays comme les États-Unis; si, en second lieu, on considère que le seul projet qui se soit présenté comme l’Alternative, le modèle communiste, a échoué autant en URSS que dans les pays du Sud comme la Chine, Cuba ou le Vietnam, il faut aussi conclure à quelque part qu’il n’y a pas une seule Alternative globale mais bien des alternatives globales qui diffèrent selon le contexte : pays du Nord ou du Sud, régions bien dotées en ressources naturelles ou pas, régime démocratique et progressiste ou régime autoritaire, société civile mobilisée fortement ou pas…. Car la logique du «tout ou rien», du capitalisme unique ou de l’Alternative au capitalisme, avec un grand A est historiquement erronée au plan du diagnostic en plus de nourrir l’impuissance, l’immobilisme ou la seule stratégie du refus. En revanche, la logique des alternatives nourrit des possibles, introduit des choix politiques et donc crée des espaces pour remettre en question les rapports de domination et favoriser des changements sociaux en profondeur.
En fait la logique des alternatives nous autorise à agir dès maintenant : chaque jour, nos sociétés font des choix qui vont dans un sens ou dans l’autre selon que la mobilisation sociale est plus ou moins forte, selon que la démocratie représentative, la délibérative et la sociale sont plus ou moins vivantes : conseils de quartier ou simples points de service des municipalités, monopole de la presse privée ou soutien à la presse indépendante, maintien du service public ou privatisation de ce service, législation du travail soutenant la syndicalisation ou la défavorisant, décentralisation ou non des services publics en région, gratuité scolaire ou hausse des droits de scolarité, priorité aux entreprises collectives dans tel ou tel secteur ou politique de privatisation, énergies fossiles ou énergies renouvelables, etc. Tous ces éléments font une différence significative. En dernière instance, ces choix quotidiens peuvent conduire à une société qui diffère passablement d’une autre tant du point de vue d’un développement équitable et durable que du point de vue de l’élargissement de la démocratie dans la perspective d’un New Deal qui cette fois-ci sera un Green Deal (Favreau et Hébert, 2012 ; Lipietz, 2012).

Encore faut-il aussi que ces alternatives locales s’enracinent le plus possible dans une stratégie globale sinon les réformes que réclament bon nombre d’organisations demeureront dans le très général…et le très flou ou dans le maintien très «corporatiste» d’une lutte de places sur le marché concurrenciel du financement public. Beaucoup d’organisations ont pour point de référence des valeurs de justice sociale, de justice climatique, d’un monde meilleur, etc… Mais elles manquent la plupart du temps d’horizon politique. Car avoir un horizon politique, c’est se donner les moyens de mordre dans les problèmes actuels les plus sensibles et y apporter des solutions concrètes et assez prochaines. Bref, une plate-forme de revendications ou de propositions pour les prochaines années, une feuille de route…pas seulement la lumière au bout du chemin espéré. Comme ont tenté de le faire les Rencontres du Mont-Blanc (RMB) en 2011 et en 2012 à Rio+20. Horizon politique qui favorise des convergences entre mouvements, lesquelles nécessitent cependant un temps long pour être réelles.
Pour en savoir plus
Sur la crise et sur le capitalisme
- Draperi, J-F. (2011), L’économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ? Capitalisme, territoires et démocratie. Éditions Dunod.
- Favreau, L. et E. Molina (2011), Économie et société, pistes de sortie de crise, PUQ, Sainte-Foy.
- Gadrey, J. (2010), Adieu à la croissance. Bien vivre dans un monde solidaire. Éd. Les petits Matins/Alternatives économiques, Paris.
- Généreux, J. (1999), Introduction à la politique économique. Seuil, Paris.
- Hall, P. et D. Soskice (2001), Varieties of Capitalism : The institutional foundations of comparative advantage. Oxford University Press.
- Lipietz, A. (2012), Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste, Éd. La Découverte, Paris.
- Petrella, R. (2007), Pour une nouvelle narration du monde, Écosociété, Montréal.
Coopératives, économie solidaire, crise écologique et développement durable
- Bourque, G., L.Favreau et E. Molina (2012), Le capitalisme en crise, quelle réponse des coopératives ? Dans la revue Vie économique, vol.3, numéro 4, Éditions Vie économique, Montréal.
- Favreau, L. et M. Hébert (2012), La transition écologique de l’économie. La contribution des coopératives et de l’économie solidaire. PUQ, Sainte-Foy.
- Larose, G. (2012), « Coopératives : la transition écologique s’impose ! » Dans Bourque, G., L. Favreau et E. Molina (2012), Le capitalisme en crise, quelle réponse des coopératives ? Dans la revue Vie économique, vol.3, numéro 4, Éditions Vie économique, Montréal.
- Le Devoir (2010), Crise alimentaire – la souveraineté alimentaire est une réponse à la crise actuelle (Réginald Harvey). Dans Le Devoir, 30 octobre 2010.
- Le Devoir (2011), Vers Rio 2012. La planète sera solidaire ou ne sera plus. Cahier spécial du journal Le Devoir, 15 et 16 octobre. Disponible sur le site du GESQ
- Le Devoir (2012), Sommet de la Terre, Rio+20. Cahier spécial du journal Le Devoir, le 20 et 21 juin. Disponible sur le site du GESQ
- Le Devoir (2012), Vers Rio 2012. Économie et environnement. Cahier spécial du journal Le Devoir, 21 et 22 avril. Disponible sur le site du GESQ
Coopératives, économie solidaire, intercoopération et coopération internationale
- Favreau, L. et E. Molina (2012), Le mouvement coopératif et la solidarité internationale. L’expérience de SOCODEVI, Edition conjointe de SOCODEVI, de l’ARUC-ISDC et de l’ARUC-DTC, Québec.
- Favreau, L., L. Fréchette et R. Lachapelle (2010). Mouvements sociaux, démocratie et développement. Les défis d’une mondialisation équitable, Québec, PUQ.
- Favreau, L., L. Fréchette et R. Lachapelle (2008). Coopération Nord-Sud et développement, le défi de la réciprocité, Presses de L’Université du Québec, Québec.
- Le Devoir,(2008), La coopération internationale québécoise et canadienne : le défi de la réciprocité (R. Lachapelle, L. Fréchette, P. Cliche) Le Devoir, 24 septembre 2008 p. A7
- Le Devoir (2008), Économie solidaire et coopération internationale La planète et ses grandes transitions (L. Favreau, G. Larose) Le Devoir, 24 septembre 2008, p. A7
- Le Devoir (2012), Pour l’intercoopération, dans Coopératives. Sommet international. Cahier spécial du Devoir, 6 et 7 octobre 2012. Entrevue de Louis Favreau par Étienne Émond Plamondon
- Le Devoir (2010) Syndicats et coopératives – Les mouvements sociaux s’investissent davantage dans la solidarité (Réginald Harvey), dans Le Devoir, 30 octobre 2010.
Coopératives, économie solidaire et action politique
- Brassard, Marie-Jöelle (2011), Coopératives et action politique, de nouveau une croisée des chemins ? Carnet de la CRDC, UQO
- Déclaration de Dakar (2005), Renforcer le pouvoir d’agir des peuples dans Favreau, L. et A.-S. Fall (2007), L’Afrique qui se refait, PUQ, Sainte-Foy, p. 379 à 383.
- Favreau, L. (2012), Mouvement coopératif, l’urgence d’une parole exprimée. Carnet de la CRDC, UQO.
- RMB (2011), Cinq chantiers et 20 propositions pour changer de modèle à l’heure de Rio+20, FIDESS, Chamonix.
- RMB (2012), Lettre aux 194 chefs d’État, FIDESS, Paris/New-York et Rio, 2012.
- Sibille, H. (2011), La voie de l’innovation sociale. Ed. Rue de l’échiquier, Paris.
[1] À noter ici que « civiliser le capital » n’est pas ici considéré comme l’objectif à atteindre en soi, mais plutôt comme le résultat d’une action collective toujours inscrite, par définition, dans un rapport de force. Ce qu’on a nommé le New Deal.
[2] Selon l’étude de Godbout et St-Cerny de l’Université de Sherbrooke (Chaire de recherche en fiscalité, 2007) dont les résultats sont parus dans le journal La Presse du 19 janvier 2008, « les petits et moyens salariés sont nettement mieux au Québec qu’ailleurs » quant à la charge fiscale.
[3] La réforme d’Obama constitue une bien maigre amélioration si on la compare avec les systèmes publics de santé comme le nôtre ou celui de la plupart des pays européens du nord et de l’ouest.
[4] Malheureusement, dans les pays du Sud, on ne peut en dire autant car celui-ci régresse dans la même période, pour les pays à moyens et bas revenus, de 20,1 % à 18,9 % (Duval, 2003).
[5] Il est entendu que l’État, avec 50% du PIB en prélèvements obligatoires, n’est pas automatiquement un État social exemplaire. La composition des dépenses doit être examiné avec soin. Mais il est à noter ici que nous parlons des États dont la réputation en tant qu’État sociaux n’est plus à faire comme les pays scandinaves par exemple. Ils ne font pas la guerre, ont des partis politiques progressistes au pouvoir de façon durable et des mouvements sociaux influents bien qu’ils sont fortement institutionnalisés.
[6] Les premiers acteurs à favoriser la production de biogaz – à partir des déchets domestiques- au Québec et donc de remplacer le pétrole par cette biomasse transformée pour leurs autobus et leurs camions sont des municipalités.
[7] EDF est l’équivalent français d’Hydro-Québec et Veolia environnement est une multinationale française dans la gestion du cycle de l’eau, de la valorisation des déchets, de l’énergie (renouvelable) et du transport des personnes.
Louis Favreau
Articles de cet auteur
- Solidarité internationale en temps de pandémie : pompiers de service ou architectes du développement ?
- Développement économique local dans les pays du Sud : l’avenir des services énergétiques
- Solidarité internationale et développement des communautés à l’heure de l’urgence climatique
- Agriculture au Québec et dans le monde : la transition sociale-écologique est déjà là !
- Le modèle progressiste à venir sera-t-il social-démocrate ou social-écologique ?

